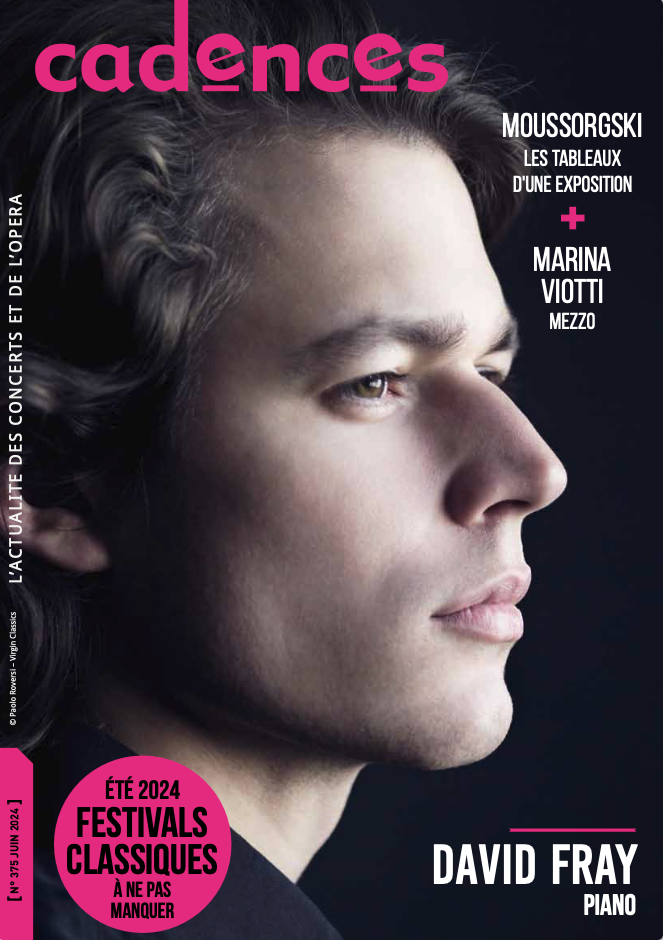Schumann Le Paradis et la Péri
 Partager sur facebook
Partager sur facebook
Oscillant entre ouvrage sacré et profane, Le Paradis et la Péri de Robert Schumann nous emmène dans un Orient féérique. Présentant une forme novatrice, la partition séduit surtout par sa riche inventivité mélodique.
Aux grandes heures romantiques du monde européen, l’Orient représentait un ailleurs irrésistiblement séduisant et mystérieux. Terre fantasmée de sensualité et d’enchantement, éveillant un imaginaire haut en couleur, on l’idéalisait volontiers. Comme bien des artistes, Robert Schumann se plongea dans cet univers à plusieurs reprises, avec notamment Le Paradis et la Péri.
La figure de la Péri évoquée dans le titre vient tout droit de la mythologie persane. Entre la fée et le génie, sorte de demi-divinité, elle connut un certain engouement au XIXe avant de retourner dans l’ombre. Elle apparaissait notamment dans le poème épique Lalla Roukh (1817) de Thomas Moore. Immense succès à sa publication, ayant captivé les lecteurs dans toute l’Europe, celui-ci fut traduit dans les principales langues du vieux continent. On y découvre un conteur qui, pour divertir une princesse, se lance dans la narration de quatre histoires : Le Prophète voilé de Khorassan, Le Paradis et la Péri, Les Adorateurs du feu et La Lumière du harem. Schumann en reçut une traduction en allemand en 1841 par son ami Emil Flechsig. Afin d’adapter le texte à la forme musicale qu’il imaginait, il demanda au poète Adolph Böttger de condenser et modifier l’œuvre originale, tout en écrivant lui-même une partie du livret.
Une morale sur la rédemption
Dans l’œuvre de Schumann, on suit donc le voyage de la Péri. Chassée du Paradis, celle-ci doit rapporter le don le plus précieux aux yeux de Dieu pour pouvoir y entrer à nouveau. Dans cette quête emblématique du paradis perdu, elle va visiter trois pays différents qui donnent à l’ouvrage sa forme tripartite. Si on y découvre les beautés inouïes des paysages orientaux, la Péri est aussi confrontée à la guerre (en Inde), aux épidémies (en Égypte) et aux crimes (en Syrie).
Dans le premier tableau, un jeune guerrier blessé s’oppose à un tyran et y trouve la mort. La Péri rapporte au ciel une goutte de son sang, symbole de l’héroïsme et de la lutte pour la liberté. Mais les portes du Paradis restent closes. Dans le second tableau, elle arrive en Égypte, qui est mise à mal par la peste. On y voit une jeune fille embrasser son fiancé malade et rendre son dernier souffle avec lui. Mais ce soupir, symbole de l’amour le plus pur, ne convient toujours pas pour que la Périe puisse regagner le Paradis. Dans le dernier tableau, en Syrie, elle croise cette fois un criminel. Ému aux larmes en regardant un enfant prier, l’homme se repend et commence à prier à son tour. Sa larme, symbole de rédemption, permet que les portes du Paradis s’ouvrent enfin.
Un oratorio « pour des gens joyeux »
Selon Schumann, Le Paradis et la Péri pose les bases d’un nouveau genre musical. Oratorio pensé « pas pour l’église, mais pour des gens joyeux » pour reprendre ses mots, il mêle profane et sacré. Il ne se contraint pas non plus à une forme traditionnelle : on ne peut y distinguer un enchainement bien découpé de récitatifs, d’airs, d’ensembles et de chœurs. Tout s’entrelace en un seul flux musical continu.
Contrairement à ce que le sujet de l’œuvre pourrait laisser imaginer, la musique ne prend pas de tournure « orientalisante ». Loin des effets pittoresques, Schumann évoque l’univers qu’il s’attache à décrire avec subtilité et la féérie prime sur l’exotisme. C’est avant tout l’orchestration qui crée les couleurs radieuses de l’Orient, avec la présence de la harpe ou encore du piccolo. L’oratorio tire avant tout sa force de sa riche inventivité mélodique et de la variété de l’écriture. Il rappelle à certains endroits le lied par son raffinement et son intimité, et assume dans d’autres pages un caractère plus grandiose.
Le Paradis et la Péri connut une genèse relativement longue. Lorsque Schumann reçut la traduction du Lalla Roukh de son ami Emil Flechsig, il n’entama pas immédiatement la composition de l’oratorio car il souhaitait se consacrer en 1841 aux symphonies. L’année suivante, il se plongea entièrement dans la musique de chambre. Par conséquent, ce n’est qu’en 1843 que Le Paradis et la Péri vit le jour, après deux années qui avaient également permis d’élaborer le livret. Schumann tenait sa nouvelle œuvre en haute estime, tout comme son épouse Clara qui en souligna la poésie. La création eut lieu le 16 décembre 1843 au Gewandhaus de Leipzig sous la direction du compositeur lui-même. Le triomphe fut tel qu’un second concert fut donné la semaine suivante, et Le Paradis et la Péri conquit en peu de temps toute l’Europe.
Elise Guignard - publié le 01/05/25