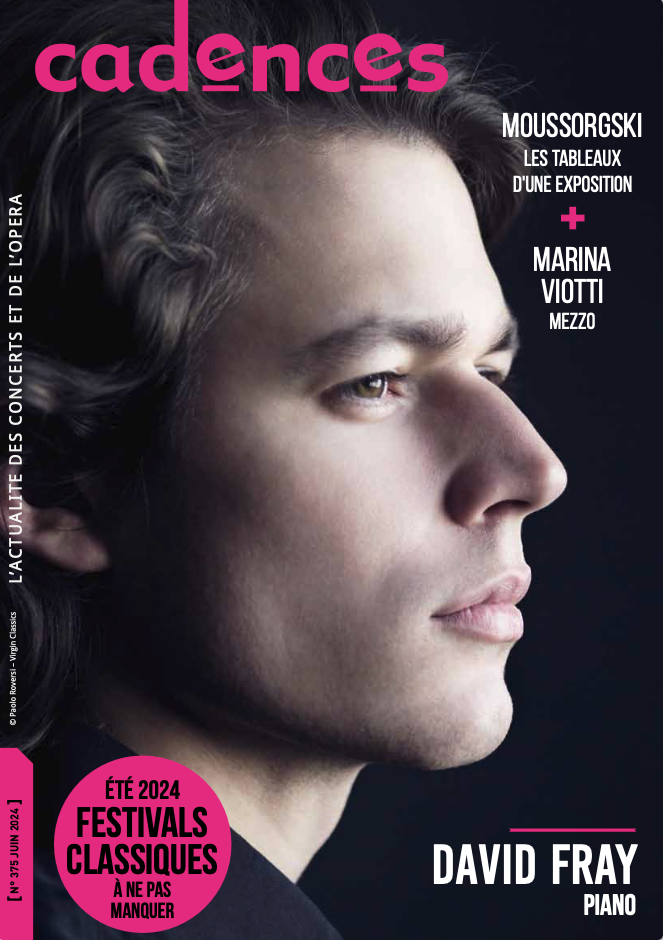Requiem de Mozart rumeurs et vérités
 Partager sur facebook
Partager sur facebook
Le Requiem de Mozart est peut-être l'œuvre qui aura suscité le plus de controverses. Les circonstances de sa composition, longtemps restées évasives, ont donné lieu à de nombreuses légendes et d'incroyables rumeurs, certaines exacerbées par l'extraordinaire film de Milos Forman, Amadeus. Mettons un peu d'ordre parmi tous ces on-dit.
1. C'est un mystérieux visiteur qui est venu passer commande du Requiem.
Faux ! Le Requiem est une commande du comte Franz von Walsegg (le contrat passé entre lui et Mozart, établi sous le contrôle de Me Sortchan notaire à Vienne, a été retrouvé en 1963). Grand amateur de musique, le comte sollicitait régulièrement des compositeurs afin d'obtenir des œuvres dont il gardait la propriété exclusive. Il les faisait ensuite jouer chez lui, laissant entendre à ses invités d'un air malicieux qu'il en était lui-même l'auteur. Pure fantaisie sans conséquence ... mais dont personne n'était dupe ! Lorsque sa jeune femme décède en février 1791, le comte souhaite honorer sa mémoire en donnant un requiem chaque année au jour anniversaire de sa disparition. Aussi, conformément à ses habitudes extravagantes, il commande à Mozart une œuvre dont il exige d'avoir la propriété exclusive. Quid alors du mystérieux visiteur dont fait mention Constance à plusieurs reprises ? Rien de plus que l'intendant du comte chargé de passer la commande sans doute. Il est probable que ce messager anonyme ne soit qu'une invention de la veuve Mozart qui, n'ayant nullement l'intention de respecter la clause d'exclusivité, souhaite pouvoir revendre librement à d'autres la partition du Requiem (ce qu'elle fera à trois reprises). La première exécution publique du Requiem à Vienne le 2 janvier 1793 lui rapportera même 300 ducats !
2. Criblé de dettes, Mozart accepte à contrecœur de composer le Requiem.
Faux ! Contrairement à certaines idées reçues, Mozart n'est mort ni dans la misère, ni dans la disgrâce. Certes, il ne refuse pas plusieurs commandes « alimentaires », son statut de compositeur de la cour lui assurant un revenu régulier mais fort maigre. Cependant, au vu du nombre d'œuvres composées en 1791, certaines étant des commandes officielles substantiellement rétribuées (La Clémence de Titus) tandis que d'autres connaissent un réel succès (La Flûte enchantée), les finances de Mozart se portent sans doute suffisamment bien pour refuser une commande, malgré les dettes accumulées qu'il doit rembourser. C'est même avec l'envie de composer une œuvre grandiose que Mozart se lance dans le Requiem, car il y voit sans doute l'occasion de s'illustrer dans un genre qu'il a négligé depuis trop d'années, lui qui vient justement d'être nommé assistant de maître de chapelle à Vienne.
3. Mozart est mort en écrivant le Lacrimosa.
Incertain. Benedikt Schack, ténor et créateur du rôle de Tamino, raconte que, la veille de sa mort, Mozart aurait fait répéter le Requiem et fondu en larmes au moment du Lacrimosa. Ce témoignage est à considérer avec précaution car, d'une part, le Lacrimosa n'était encore qu'à l'état d'ébauche. D'autre part, comment imaginer une répétition avec pour support un unique manuscrit, partiellement orchestré ? On voit cependant que l'écriture de Mozart s'achève bien à la huitième mesure du Lacrimosa, et il est possible que son Requiem l'ait effectivement accaparé jusqu'à la fin. Sa belle-soeur, Sophie Haibel, raconte : « La dernière chose qu'il fit fut d'exprimer avec la bouche les timbales de son Requiem ». Et pourtant, plus encore que le Requiem, c'est vers son opéra La Flûte enchantée que semblent se diriger les pensées de Mozart à ses derniers instants. Lorsqu'il ne peut plus assister aux représentations, il imagine de chez lui leur déroulement, une montre posée à ses côtés. Et la veille de sa mort, il aurait dit : « Je voudrais bien entendre encore une fois ma Flûte enchantée ».
4. Plusieurs compositeurs ont participé à l'écriture du Requiem.
Vrai ! Grâce aux analyses graphologiques, nous savons avec certitude que Mozart a composé de son vivant l'Introït entièrement, le Kyrie en grande partie, ainsi que basse continue, parties vocales et ébauches d'orchestration de la Séquence et de l'Offertoire. À sa mort, Constance, en quête d'un compositeur capable d'achever l'œuvre, se tourne premièrement vers Eybler, un ami de Mozart. Celui-ci accepte, puis se rétracte, sans doute effrayé par l'ampleur de la tâche. Le manuscrit montre qu'il aurait ajouté les parties de timbales et trompettes de la Séquence. Il semble que deux autres amis de Mozart, Freystatdler et l'abbé Stadler, aient également apporté, dans une moindre mesure, leur contribution au manuscrit. Constance s'en remet finalement à Franz Xaver Süssmayer, élève de Mozart, souvent présent au chevet de son maître et auprès duquel il aurait recueilli des indications quant à l'achèvement du Requiem. Süssmayer aurait également tiré profit de quelques bouts de papier trouvés sur la table de Mozart après sa mort. Doté d'une écriture très proche de celle de son maître, il copie et complète ainsi la partition destinée au comte Walsegg.
5. Süssmayer s'est faussement attribué en grande partie la composition du Requiem.
Vrai ! L'attitude de Süssmayer est pour le moins ambiguë. En effet, il signe le manuscrit « di me W. A. Mozart » mais ajoute l'année 1792, alors que chacun sait que Mozart était déjà mort. Ensuite, sous le faux prétexte de rendre justice à son maître, il écrit en 1800 une lettre aux éditions Breitkopf, détaillant sa contribution dans la composition du Requiem. En réalité, cette lettre dans laquelle il s'attribue la paternité du Sanctus, du Benedictus et de l'Agnus Dei, n'est rien de plus qu'un moyen de faire valoir ses droits sur les ventes de la partition. Les analyses graphologiques peuvent déterminer ce qui est de la main de l'élève, mais rien ne prouve qu'il n'ait pas écrit sous la dictée de son maître ou d'après ses esquisses ! Aussi, en s'appuyant sur les propres compositions de Süssamyer (de qualité relativement faible), les experts ont tenté de déterminer quelle fut exactement sa contribution. Il semble bien être l'auteur du Sanctus, qui ressemble de manière troublante à celui de sa propre Messe en ré. Les deux Osanna, d'écriture assez maladroite, pourraient bien être également de sa main. De plus, on sait que Mozart envisageait une fugue sur l'Amen final du Lacrimosa (dont on a retrouvé des esquisses), là où Süssmayer a choisi une sobre cadence plagale. En revanche, le Benedictus proviendrait d'un cahier d'exercices destiné à une autre élève de Mozart, Barbara Ployer. Enfin, la qualité musicale de l'Agnus Dei (l'accompagnement des cordes, la modulation finale... ) nous porte à croire qu'il provient bien de Mozart. Cela ne fait aucun doute pour l'abbé Stadler qui déclare en 1825, à propos du Requiem : « Tout ce qui est essentiel vient de Mozart lui-même ».
Depuis deux siècles, le Requiem n'a cessé de tourmenter les musicologues en quête de vérité. De nombreux compositeurs insatisfaits se sont emparés de l'œuvre en réécrivant les parties supposées être de Süssmayer, tentant de se rapprocher au mieux de l'esprit de Mozart. Quoi qu'il en soit, le Requiem a connu, dès sa première exécution, un succès dont il ne s'est pas départi jusqu'à aujourd'hui. Alors peut-être que sa popularité ne réside pas dans la qualité de son écriture musicale, sans cesse remise en question par endroits, mais dans l'aura de mystère qui l'entoure et dans l'histoire qu'il porte, indéfectiblement liée aux derniers instants d'un compositeur de génie.
Floriane Goubault - publié le 01/05/25