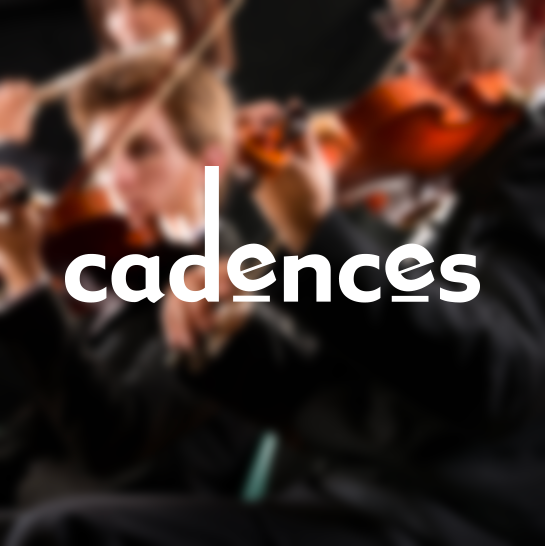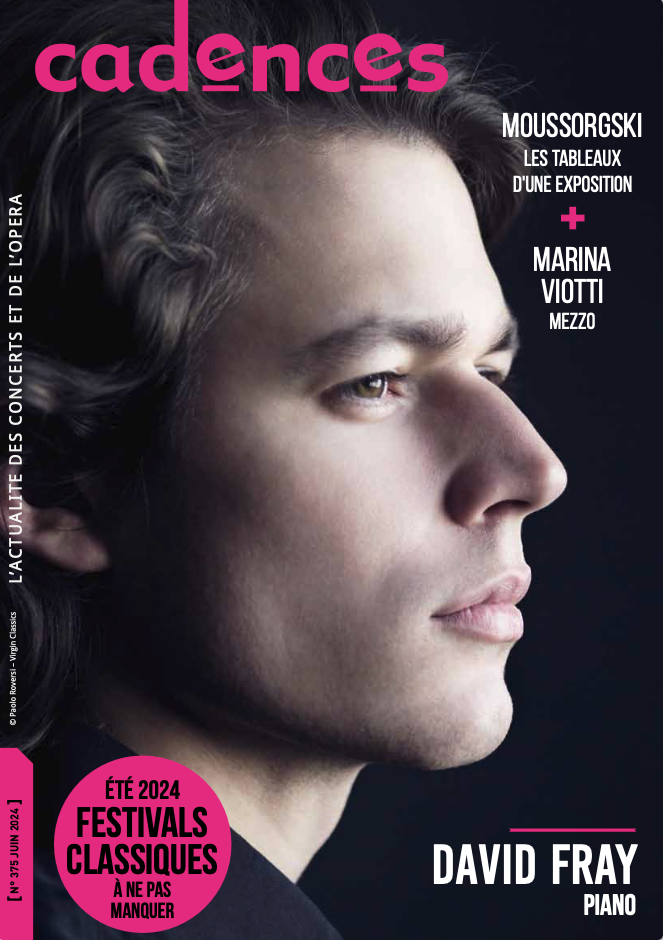Händel Theodora
 Partager sur facebook
Partager sur facebook
En 1996, le tandem Christie/Sellars dévoilait au monde l'irréelle beauté de Theodora, peut-être le plus émouvant oratorio de Händel. Loin des fracas grandioses associés à son nom, ce dernier composa une partition personnelle, qu'il chérissait par-dessus tout.
L 'oratorio anglais n'évinça nullement l'opéra italien en une seule nuit. Dès 1718, avec Esther, Händel s'attacha à adapter à la langue anglaise l'oratorio, qu'il avait découvert en Italie dans les années 1707/1708. Certes, Esther vit le jour dans le cadre très exclusif du cénacle de James Bridge, futur Duc de Chandos, et il fallut attendre près de quinze ans pour que Händel se penchât de nouveau sur l'oratorio dans une perspective cette fois publique. En 1733, Deborah puis Athalia posèrent de solides fondations, alors même que le compositeur se battait encore pour l'opéra italien - la préparation de Deborah s'effectua au moment où Orlando occupait le devant de la scène. Le tournant survint avec cette attaque du 13 avril 1737 qui paralysa partiellement Händel. Ce dernier se remit vite mais l'épisode bouleversa profondément son état d'esprit, le développement de I’oratorio anglais connaissant alors une accélération significative avec Saul et Israel in Egypt (1739), The Messiah (1742), Samson (1743), Belshazzar (1745), Salomon (1749), Theodora (1750) et enfin Jephtha (1752). En 1740, Händel livra ses deux derniers opéras avec lmeneo et Deidamia, tournant la page italienne.
Le compositeur prenait acte d'un fort mouvement appelant de ses vœux la renaissance d'une musique nationale anéantie par la mort en 1695 de Henry Purcell. La position adoptée par les thuriféraires d'une musique vocale en anglais s’avérait être aussi une aspiration de type morale. Beaucoup déploraient ainsi le fait que le public de l'opéra italien ne comprenait goutte aux livrets et, de ce fait, s'abandonnaient sans frein aux simples plaisirs hédonistes du beau chant, se souciant peu des leçons morales que l'art se devait d'inculquer. De fait, Thomas Morell, le librettiste de Theodora, puisa précisément dans un roman moral de Robert Boyle, The Martyrdom of Theodora and Didymus. Ouvrage dont l'objectif était clairement de proposer des héros et heroïnes dont le comportement devait montrer la voie à la jeunesse aristocratique. Boyle tirait lui-même son inspiration de Saint Ambroise, évêque de Milan du IVe siècle après Jésus Christ, leur Père de l'Église.
Theodora fut un four
Or, la création de Theodora le 16 mars 1750 au Covent Garden compta parmi les plus grands fours de la carrière de Händel : seulement trois représentations pour une œuvre qu’il chérissait de tout son cœur, tout en ne se faisant guère d'illusion, selon toute apparence, sur l'accueil du public anglais. Ce dernier, selon les propos de Händel, n’aimait que ce qui « les frappait au tympan de l'oreille » et le lyrisme sombre, voire introverti, de Theodora tournait quelque peu le dos à la grandiloquence belliqueuse que le compositeur lui-même avait cultivée dans Judas Maccabeus et The Occasional Oratorio (tous les deux en 1746) ou dans Joshua (1747), les « trois oratorios de la victoire », dont le succès était très redevable aux frayeurs suscitées par la Révolution jacobite visant à restaurer les Stuart sur le trône d'Angleterre puis au soulagement général après son écrasement en 1746.
Hormis les célébrations païennes au Temple de Vénus qui ouvrent l'acte II, au demeurant d'un éclat tout relatif, l'œuvre se meut, tout au long de ses trois actes, au gré de couleurs pastels, au clair-obscur savamment distillé, surmontant - ou peut être tirant parti - d'un poème que d'aucuns ont décrit comme insipide.
Le gouverneur romain d'Antioche, Valens, ordonne que toute la ville, sous peine de mort, participe aux cérémonies organisées en l'honneur de Jupiter. Malgré les exhortations à la démence de Didymus, un jeune soldat, il envoie des soldats arrêter la foule des chrétiens réunis autour d'Irene et de Theodora, jeune aristocrate, qui refuse de se soumettre au décret de Valens. Ce dernier la condamne à se prostituer dans le temple de Vénus. Didymus, épris de Theodora et secrètement converti au christianisme, obtient de son ami le centurion Septimus l'accès à la prison dans laquelle est enfermée sa bien-aimée. Il la convainc de s'échapper en la dissimulant sous son propre manteau. Mais apprenant l'arrestation de Didymus, Theodora se rend aux Romains, Valens lui épargne au final l'indignité du viol et condamne à mort les jeunes amoureux qui vont ensemble à la rencontre de leur fin.
Un personnage presque masochiste
Theodora peut paraître, à plus d'un moment, comme enfermée dans une résolution presque masochiste d'accepter, voire d'appeler de ses vœux, le martyre : il est hautement significatif que le seul air en tonalité majeure, Angels, ever bright and fair, survienne après l'annonce de son supplice à venir et illustre sa volonté de se soumettre à la volonté divine. Toutefois, l'extraordinaire douceur et tendresse de la musique parvient à lui conférer une humanité éclatante. Baignant dans des couleurs orchestrales sombres et saisissantes, la scène de la prison, faisant se succéder dans l'acte II deux récitatifs et deux airs en alternance, possède un impact émotionnel sans égal. Le duo qu'elle chante avec Didymus avant de s'échapper de sa prison dans l'acte II, le célèbre To thee, thou glorious son of worth, compte parmi les pages les plus fameuses de Händel.
À l'inverse de son aimée, Didymus, le jeune héros valeureux et si empli de compassion, évolue dans des tonalités essentiellement majeures et une vocalité sereine jusque dans les moments les plus théâtraux. L'air Sweet Rose and Lily, qu'il chante en contemplant Theodora endormie à l'acte II, déploie une suavité céleste.
Mais ce sont peut-être les personnages secondaires qui nous touchent particulièrement. Témoin impuissante des événements, Irene irradie d'une tendresse bienveillante et d'une foi tranquille qui s'expriment dans toute leur force à travers le célébrissime When with rosy steps, serti dans un écrin instrumental scintillant qui évoque le plus glorieux des levers de soleil, ou l'air Lord to thee each night and day ouvrant l’acte III, d'une noblesse qui s’anime peu à peu de l'espoir le plus exalté.
Si Valens ne propose qu’une raideur explosive, le centurion Septimus est à l'inverse l’image de l'homme « ordinaire », ému par la cruauté de son gouverneur (Descend, kind pity de l'acte I), bouleversé par le sort de Didymus et de Theodora, mais ne pouvant se résoudre à désobéir, ne parvenant guère à comprendre I’obstination des chrétiens (Dread the fruits of christian folly, l'air le plus virtuose de la partition).
Mais la grande ligne de démarcation entre l'opéra Italien et l'oratorio anglais réside dans la présence du chœur, un chœur qui, ici, à l'image des passions de Bach, incarne tout aussi bien la foule païenne que la communauté des chrétiens. Le chœur des Romains tourne toutefois plus ses regards vers une sensualité coupable (Queen of summer, Queen of love ouvrant l'acte II) qu'une barbarie véritable et débridée. Sans surprise, Händel a recours au contrepoint le plus glorieux pour évoquer le chœur des chrétiens qui ponctue immanquablement chaque acte par une page grandiose, particulièrement le hiératique He saw the lovely youth - que Händel plaçait au-dessus de son célèbre Hallelujah du Messie – à la fin de l’acte II et, bien sûr, le chœur final Oh Love divine. Réminiscence de ses origines allemandes ? Sans doute, mais il ne faut pas oublier l’ombre de Purcell, à laquelle Händel savait devoir se mesurer. Le tour de force réalisé avec Theodora consista indiscutablement à réussir la synthèse du drame humain et de la renaissance d’une tradition musicale véritablement anglaise.
Yutha Tep - publié le 01/10/25