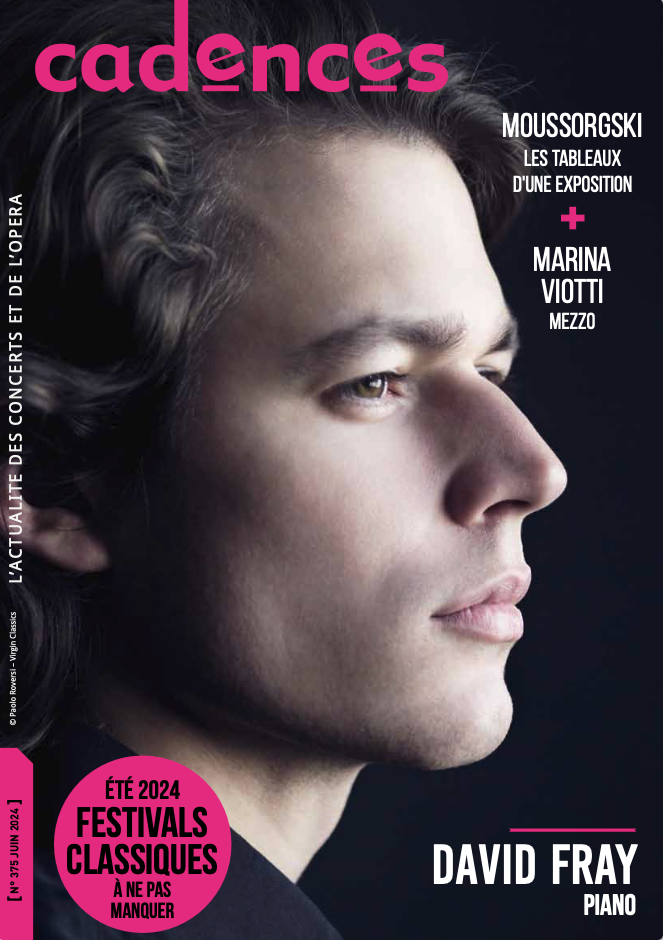Philip Glass l'inclassable
 Partager sur facebook
Partager sur facebook
Il est l’un des compositeurs vivants les plus joués au monde. Affranchi des codes de la musique savante occidentale, Philip Glass a suivi de multiples chemins au cours de sa vie. En octobre, on peut réentendre ses Études pour piano à la Cité de la Musique par Vanessa Wagner et son opéra Akhnaten à la Philharmonie.
Né en 1937 à Baltimore, Philip Glass fait son lycée à Chicago. Il y découvre la musique jazz et se lance ensuite dans des études de mathématiques et de philosophie. Il se forme en musique au sein de la prestigieuse Juilliard School à New York, puis part en Europe en 1964 pour se perfectionner auprès de Nadia Boulanger. Durant deux ans, il suit l’enseignement rigoureux de cette pédagogue aussi renommée que sévère, se construisant une solide technique en harmonie, contrepoint et analyse qui lui servira toute sa vie. Il fait à la même période plusieurs découvertes déterminantes qui vont marquer à jamais sa vision de la musique et façonner son identité artistique. D’abord, l’univers de Samuel Beckett, car il compose une musique de scène pour la pièce Play. Philip Glass s’intéresse à la narration déconstruite du dramaturge, dont on trouvera d’ailleurs des similitudes dans ses propres compositions. Une autre étape essentielle pour lui est la rencontre de Ravi Shankar, dont il est chargé de transcrire la musique pour le film Chappaqua. Il découvre par ce biais la musique indienne, avec son approche si différente de la pensée occidentale. Les structures rythmiques complexes en sont le cœur battant, avec une conception harmonique secondaire, presque invisible par moments. Alors que Philip Glass est encore plongé dans sa formation très classique, cette découverte est une révélation. Après un voyage en Inde, le compositeur rentre à New-York en 1967 et se lance pleinement dans la composition. Il fonde le Philip Glass Ensemble, qui lui permet de créer beaucoup de ses œuvres.
Une « musique à structures répétitives »
Le milieu musical rattache Philip Glass au minimalisme, un courant américain qui cherche à s’éloigner de l’influence de Boulez et du sérialisme. Les principaux minimalistes, Steve Reich, Terry Riley et La Monte Young, s’intéressent particulièrement aux structures répétitives et à l’épure, sans renier le système tonal. Sans se reconnaitre pleinement dans ce terme, préférant parler de « musique à structures répétitives », Philip Glass travaille sur la répétition de courts motifs mélodiques. Mais cette répétition n’est jamais parfaite et inflexible, c’est là toute sa subtilité. Il développe un style personnel faussement simple, explorant de multiples univers au fil de sa carrière qui empêchent toute tentative de catégorisation. Une partie du milieu musical considère longtemps sa musique comme peu « sérieuse », d’autant plus que le compositeur efface la frontière entre répertoire savant et populaire et décloisonne les arts. À New York, il côtoie le milieu artistique sous toutes ses facettes, des cercles underground à l’avant-garde, du rock à la littérature de la Beat Generation. Il fréquente John Cage, Yoko Ono ou encore Moondog, et s’inspirera plus tard de David Bowie pour ses Low Symphony et Heroes Symphony. Cet univers marque durablement sa démarche : il y puise une liberté formelle radicale et le désir de toucher un public plus large que l’élite académique.
Une œuvre protéiforme
L’œuvre de Philip Glass traverse l’ensemble du spectre des genres musicaux. Le musicien compose des œuvres de musique de chambre, des symphonies, des concertos, des opéras, des musiques de films… Du côté de la musique pour piano, les Études pour piano font partie des incontournables. Celles-ci, au nombre de vingt, furent composées entre 1991 et 2012. Philip Glass les concevait à la fois comme des outils pour perfectionner son propre jeu pianistique (notamment celles du Livre I) et comme un terrain d’exploration. Elles développaient en outre son répertoire de concert solo. Par leur variété, elles constituent une porte d’entrée idéale dans son univers musical. Dans le domaine lyrique, Philip Glass a profondément bouleversé son temps. C’est l’opéra Einstein on the Beach qui l’a d’ailleurs rendu célèbre dans les années 1970. Conçue avec Bob Wilson et affranchie de toute narration conventionnelle, cette œuvre inclassable fit l’effet d’un coup de tonnerre dans le milieu musical lors de sa création à Avignon, avant de triompher au Met de New-York. Elle constitue le premier opus de ce qu’on nomme la « trilogie des portraits », avec Satyagraha (créé en 1980 à Rotterdam) qui est consacré à Gandhi et Akhnaten (créé 1984 à Stuttgart), qui s’intéresse au pharaon égyptien Akhénaton, célèbre pour avoir instauré le culte monothéiste du dieu solaire Aton. Aujourd’hui, on compte plus de 25 opéras, sans oublier une série d’œuvres scéniques difficiles à catégoriser comme 1000 Airplanes on the Roof (1988), créée dans un aéroport.
Elise Guignard - publié le 01/10/25